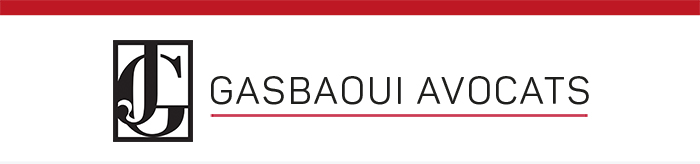 |
|
 |
|
|
ATTENTION AUX CONVENTIONS DE MANAGEMENT FEES |
|
Les bonnes définitions font les bons débats. La formule générale est particulièrement bien adaptée aux managements fees.Également appelés "contrat de gestion ou de management", les management fees permettent de confier une mission de direction ou de représentation, voire les deux généralement à une société tierce, dont il est convenu qu'elle sera accomplie personnellement par le biais de son propre représentant légal. Cette mission s'accomplit alors parallèlement à celle qui incombe au dirigeant social et sert notamment la structuration de groupes. Aussi, sous l'anglicisme, se cache la vraie qualification : une convention de prestation de service. Il faut ainsi revenir à cette qualification élémentaire et se méfier de toute convention s'en écartant. Elle est en effet souvent utilisée comme un moyen de pallier l'absence de dividendes distribuables et permettant de faire circuler de la trésorerie (souvent pour le remboursement d'un emprunt) sur un fondement pas toujours solide. Pour qu'une convention de management fees ne présente pas de risque, il faut que la société établisse des factures correspondant à une prestation réelle ! Cette recommandation prend bien évidemment tout son sens à la lecture des premiers arrêts intervenus sur la question (Cass. com. 14 sept. 2010, n°09-16.084 ; Cass. com. 23 oct. 2012, n°11-23.376). Ceux-ci avaient retenu une solution identique, la nullité sur le fondement de la cause alors que le directeur général d'une SA avait confié des missions de direction à une société qu'il dirigeait, par une convention de prestation de services. Dans ces deux cas, la convention revenait à rémunérer des prestations qui étaient en réalité déjà accomplies par le mandataire social dans le cadre de ses fonctions de direction. Ces solutions restent valables après la réforme du droit des contrats et la mise en jeu de la responsabilité du dirigeant est alors également potentielle. Mais derrière ces conséquences sur le terrain civil, celles qui, beaucoup plus graves, peuvent survenir sur le terrain pénal ne doivent pas être négligées. L'arrêt Lagardère en est d'ailleurs un bel exemple en retenant l'existence d'un abus de biens sociaux, peu important que l'usage abusif des biens sociaux n'ait pas eu lieu à des fins exclusivement personnelles (Cass. crim., 25 octobre 2006, n° 05-85.998). La jurisprudence est ainsi tellement défavorable aux conventions de managements fees, que la vraie question est en réalité de savoir s'il reste des situations où elles sont licites ! Si la réponse demeure évidemment affirmative, car les différents arrêts laissent une brèche ouverte, la prudence s'impose. Il semble à cet égard qu'est valable la prestation délivrée par un prestataire qui est tiers par rapport à la société cliente, c'est-à-dire qui n'a pas, directement ou par interposition, la qualité d'organe de la société cliente. (V. aussi : Cass. com., 3 mars 2015, n° 13-25094 ; Cass. com., 12 déc. 2018, n°16-15217). Mais cette seule précaution reste insuffisante. Il convient également de tenir compte des spécificités de la société qui sollicite la prestation de service. Plus précisément, le caractère impératif ou non de la répartition des pouvoirs des organes sociétaires doit être préalablement cerné. |
|
L'idée essentielle est simple : il faut être en capacité de démontrer que le service rendu ne fait pas doublon avec l'activité de direction.En ce qui concerne la SA, la répartition légale des pouvoirs entre les organes doit être considérée comme impérative (comme pour la SARL vraisemblablement). Dès lors, il est certain qu'on ne peut confier conventionnellement à un tiers prestataire, la direction générale de la société ou un pouvoir général de représentation à l'égard des tiers en vertu des articles L. 225-51-1 et L. 225-56 du Code de commerce. En revanche, un dessaisissement partiel paraît possible : semblent ainsi valables les conventions portant sur des tâches administratives précises, comme la comptabilité, la gestion des ressources humaines ou la gestion du parc immobilier ; qui organisent des prestations qui requièrent une compétence spécialisée (prestations techniques, financières, administratives, commerciales) sans se superposer avec l'objet social (V. not. : Cass. com., 6 déc. 2016 n°15-11.105). En ce qui concerne la SAS, la direction générale est organisée librement par les statuts, selon l'article L. 227-5 du Code de commerce. Seule est réglementée la représentation légale de la société, confiée au président et éventuellement aux directeurs généraux et directeurs généraux délégués par l'article L. 227-6. Si les statuts n'en disposent pas autrement, on peut ainsi en déduire que la direction peut être confiée à un autre que ces protagonistes. Deux situations méritent donc d'être distinguées :
Néanmoins, il ne faut sans doute pas croire que la solution consistant à ne conférer qu'un pouvoir de représentation au président serait exempte de toutes critiques. Ce dernier doit conserver un rôle effectif. Il ne paraît pas concevable d'externaliser contractuellement l'intégralité des fonctions de direction générale et ainsi priver la collectivité des associés, comme le président lui-même, de tout pouvoir de contrôle sur la façon dont la société est dirigée. Si de ce point de vue, la maîtrise du risque lié à la conclusion d'une convention de management fees reste possible, cette dernière se fait donc au prix d'importantes précautions à prendre dans un contexte incertain. Non seulement ces lignes de force ne sont pas clairement arrêtées, mais aussi les questions encore en suspens demeurent nombreuses : quid du régime applicable aux tiers exerçant des fonctions de direction ? Qu'en est-il des règles relatives à la responsabilité ? Aux conventions réglementées ? À la représentation et aux limitations de pouvoir ? Celles-ci sont autant de zones d'ombre qui incitent à la plus grande vigilance en la matière.
|
|
© 2020 JULIEN GASBAOUI |